Diffusions passées:
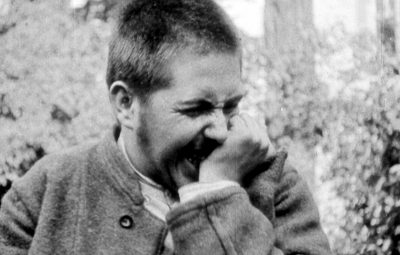
Quand la Grande Guerre rend fou, diffusion du jeudi 06 décembre 2018 à 03h05
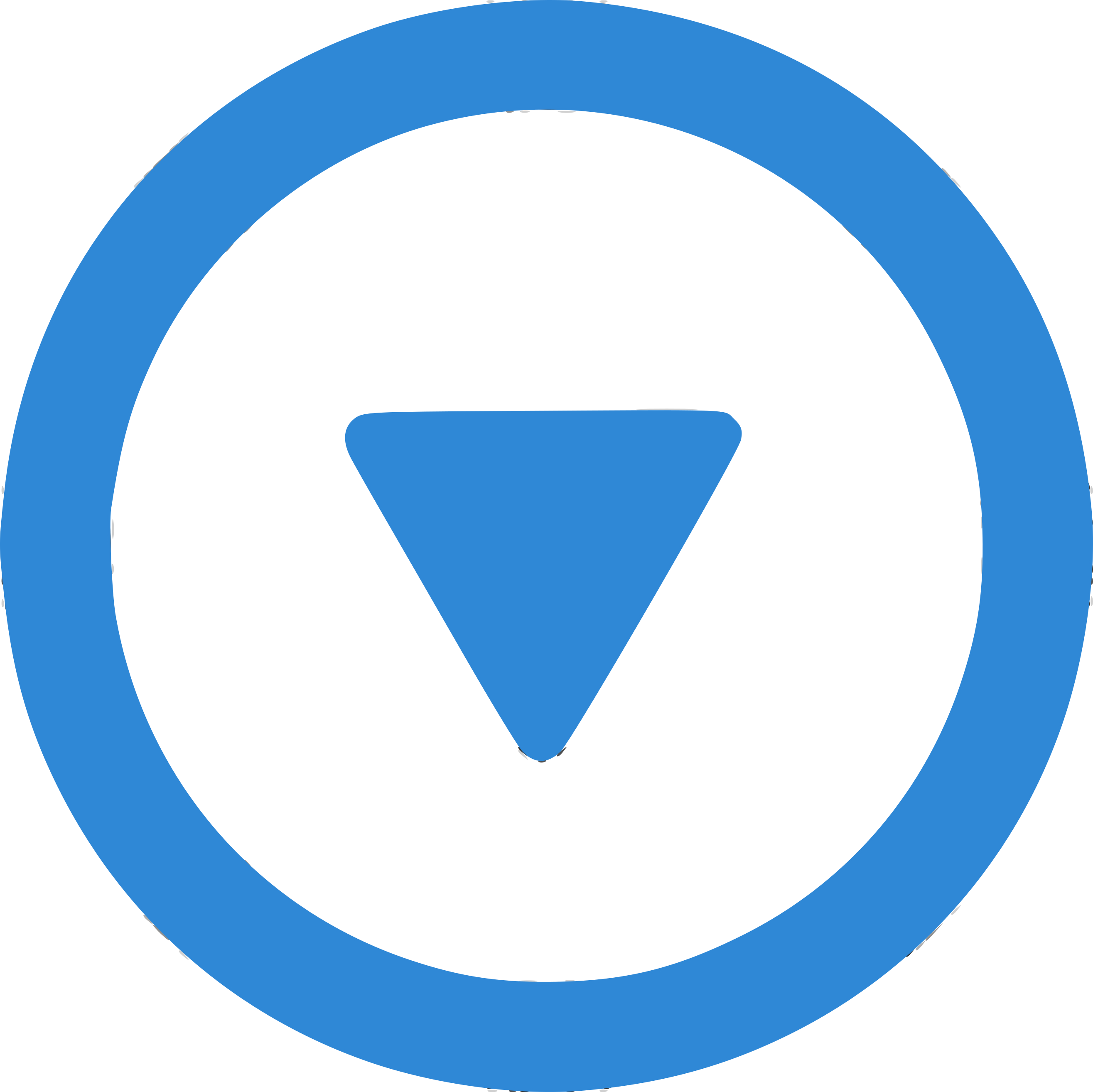
Durant la Première Guerre mondiale, nombreux sont les soldats qui ne se sont jamais remis du spectacle quotidien de l'horreur auquel ils ont assisté sur le front. C'est le cas notamment de Baptiste Deschamps qui, dès septembre 1914, s'est retrouvé prostré après un bombardement. Or, les médecins, réfractaires à la psychanalyse, importée d'outre-Rhin, se montrent impuissants face à ce type de souffrance. Promené d'hôpital en hôpital, Baptiste Deschamps se voit appliquer des méthodes douces, avant de subir la technique de Clovis Vincent, étoile montante de la neurologie française, qui consiste à infliger au patient des décharges d'électricité, pour que la douleur physique prenne le pas sur la souffrance psychique. Critique : Dans les images de défilés commémorant la victoire, les gueules cassées figurent en bonne place. Aucune trace, en revanche, des dizaines de milliers d’hommes que la Première Guerre mondiale a cabossés sans laisser de blessures apparentes. Pour les médecins de l’époque, ces soldats retrouvés sur les champs de bataille recroquevillés en position fœtale, soudain incapables de parler, de voir ou de marcher alors qu’aucune de leurs fonctions vitales n’a été touchée, cristallisent les interrogations, lesquelles se muent vite en suspicion. Tenus pour des « profiteurs de guerre » se prélassant dans les hôpitaux psychiatriques quand d’autres meurent sous les balles ennemies, beaucoup subiront des séances d’électrothérapie avant d’être renvoyés au front. Comme dans son ouvrage Les Soldats de la honte (1) , dont ce documentaire est, plus qu’une adaptation, une illustration un peu confuse, l’historien Jean-Yves Le Naour suit le cas particulier de Baptiste Deschamps. Un paysan viennois traumatisé de guerre qui, refusant le « traitement » qu’on voulait lui imposer, fut l’un des premiers à attirer l’attention collective sur ce que l’on nomme aujourd’hui « stress post-traumatique ». (1) Paru aux éd. Perrin en 2011.
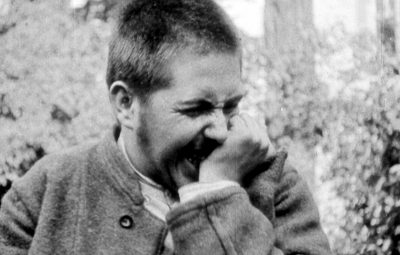
Quand la Grande Guerre rend fou, diffusion du vendredi 09 novembre 2018 à 00h45
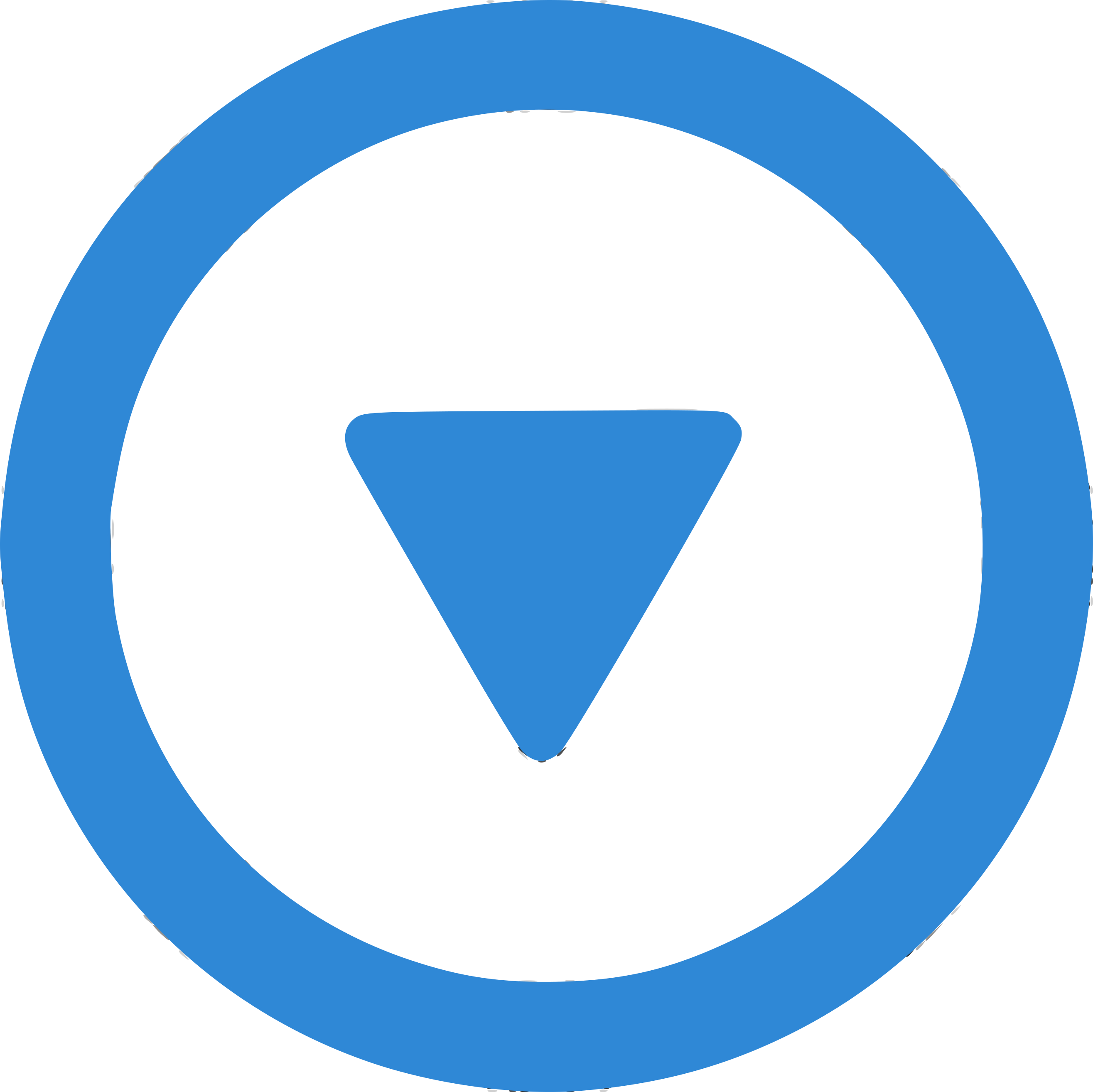
Durant la Première Guerre mondiale, nombreux sont les soldats qui ne se sont jamais remis du spectacle quotidien de l'horreur auquel ils ont assisté sur le front. C'est le cas notamment de Baptiste Deschamps qui, dès septembre 1914, s'est retrouvé prostré après un bombardement. Or, les médecins, réfractaires à la psychanalyse, importée d'outre-Rhin, se montrent impuissants face à ce type de souffrance. Promené d'hôpital en hôpital, Baptiste Deschamps se voit appliquer des méthodes douces, avant de subir la technique de Clovis Vincent, étoile montante de la neurologie française, qui consiste à infliger au patient des décharges d'électricité, pour que la douleur physique prenne le pas sur la souffrance psychique. Critique : Dans les images de défilés commémorant la victoire les années suivant l'armistice, les gueules cassées figurent en bonne place. Aucune trace, en revanche, des dizaines de milliers d'hommes que la Première Guerre mondiale a cabossés sans laisser de blessures apparentes. Pour les médecins de l'époque, ces soldats retrouvés sur les champs de bataille recroquevillés en position foetale, soudain incapables de parler, de voir ou de marcher alors qu'aucune de leurs fonctions vitales n'a été touchée, cristallisent les interrogations, lesquelles se muent vite en suspicions. Tenus pour des « profiteurs de guerre » se prélassant dans les hôpitaux psychiatriques quand d'autres meurent sous les balles ennemies, beaucoup subiront des séances d'électrothérapie avant d'être renvoyés au front. Comme dans son ouvrage Les Soldats de la honte (1) , dont ce documentaire est, plus qu'une adaptation, une illustration un peu confuse, l'historien Jean-Yves Le Naour suit le cas particulier de Baptiste Deschamps. Un paysan viennois traumatisé de guerre qui, refusant le « traitement » qu'on voulait lui imposer, fut l'un des premiers à attirer l'attention collective sur ce que l'on nomme aujourd'hui le « stress post-traumatique ». — Emilie Gavoille (1) Paru chez Perrin en 2011.

