Diffusions passées:

L’heure d’été, diffusion du jeudi 01 février 2018 à 13h35
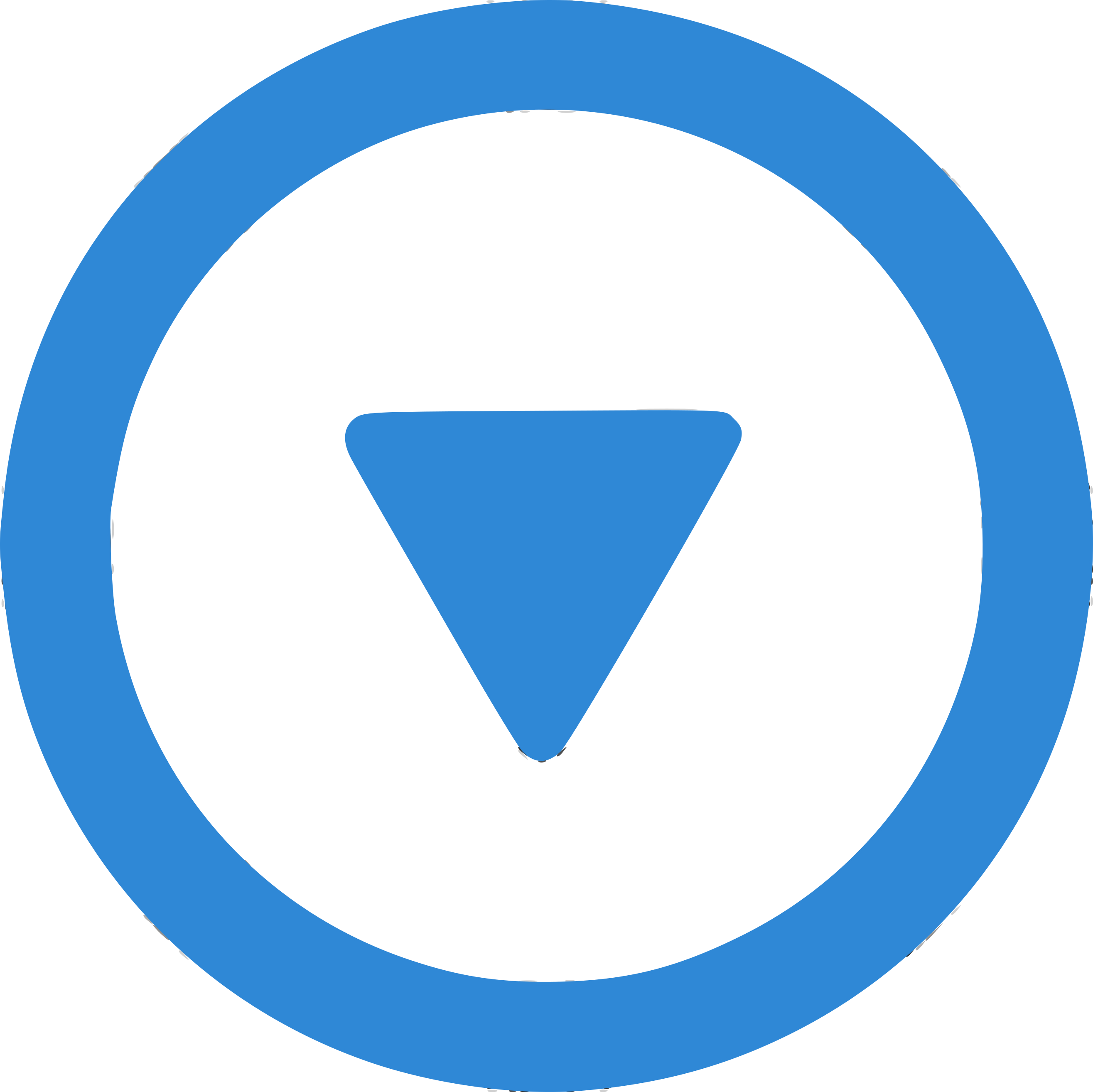
A la mort de leur mère, les héritiers d'un peintre s'interrogent sur ce qu'ils doivent préserver du passé familial. Chronique élégiaque, d'une intelligence aiguë, sur la question de vivre (ou non) avec la culture. Critique : Il y a deux visages chez Olivier Assayas, qui ne sont pas contradictoires. D'une part l'homme électrisé par le présent qui réfléchit aux mutations du monde à travers des films de genre plus ou moins orthodoxes. Ce sont Demonlover ou Boarding Gate, faux polars situés entre Europe et Asie, entre zones de transit et hôtels de luxe, reflétant une drôle d'attirance-répulsion vis-à-vis de la modernité mondialisée. Mais il y a aussi l'honnête homme au sens où on l'entendait jadis, attaché à l'art de vivre que cette nouvelle donne menace ou rend obsolète. Un esthète cultivé qui sait la valeur du passé et de l'art que celui-ci a enfanté. L'Heure d'été semble renouer avec la seconde veine, celle de Fin août, début septembre, par exemple. L'approche est apparemment plus locale, voire strictement franco-française. Le film se passe à Paris et ses alentours, au sein d'une bourgeoisie intellectuelle et artiste. Il est construit en longues séquences, presque des actes, et décrit au rythme des saisons un processus simple : la nièce d'un peintre imaginaire mort au début des années 70, une sorte de Bonnard francilien, gardienne de sa mémoire, légataire des objets d'art qu'il a collectionnés de son vivant, sent sa fin prochaine. C'est Edith Scob qui l'incarne, impec en mémé sèche et ronchonne acceptant de mauvaise grâce qu'on lui offre un plaid, « un cadeau de vieux ». Elle réunit ses grands enfants. Deux « internationalistes » : une fille designer qui vit à New York (Assayas a conseillé à Juliette Binoche de rencontrer la créatrice Matali Crasset pour composer son personnage) et un fils cadet, chef d'usine en Chine pour un équipementier sportif (Jérémie Rénier, tête de premier d'HEC). Face à eux, pour qui la France est trop étroite, le fils aîné, les pieds dans l'ancien monde, prof d'éco à Sciences-Po, essayiste contesté et médiatique (Charles Berling, qui joue à merveille la bonne volonté un peu maladroite). A la mort de la vieille dame, les questions se multiplient. Que faire des souvenirs : faut-il entretenir la mémoire du grand homme ou partager l'héritage ? Comment gérer l'impossible équation entre la valeur affective des pièces et leur valeur marchande ? A fortiori quand il s'agit d'objets ayant - plus qu'un tableau ou une sculpture - un usage courant : un bureau Art nouveau de l'ébéniste Louis Majorelle, un vase du graveur et céramiste Félix Bracquemond. Faut-il travailler sur l'un, mettre des fleurs dans l'autre, ou bien les céder à l'Etat, ou encore les vendre à meilleur prix à un collectionneur ? Ces questions très théoriques, Olivier Assayas a l’art de les incarner dans une chronique toujours juste. C’est à la fois très écrit – avec cette intelligence aiguë qui est la marque du cinéaste – et d’une fluidité dans la mise en scène qui donne vie aux scènes de groupe, déjeuner de famille en plein air, dîner de tractations entre héritiers, fête d’ados émancipés dans la grande maison mise en vente. La qualité générale de l’interprétation (seconds rôles compris, à l’image de Dominique Reymond, Valérie Bonneton, Eric Elmosnino ou Jean-Baptiste Malartre) invite à penser au cinéma de groupe, de troupe, de Claude Sautet – en plus conceptuel –, et ce n’est pas un mince compliment. « Les oeuvres qui passaient de l'amour au grenier peuvent passer de l'amour au musée, mais ça ne vaudra pas mieux, écrivait André Malraux. Toute oeuvre est morte quand l'amour s'en retire. » Olivier Assayas a tourné L'Heure d'été avec (et en partie dans) un musée, tout en critiquant la « muséification » du monde. Approche élitiste, certes, mais immédiatement contredite par la pratique même d'un art populaire, le cinéma. A Charles Berling, qui essaie de connaître la valeur de deux petits Corot, clous de l'héritage, un expert répond, navré, que « le marché international n'identifie pas bien cet artiste, et que les sujets choisis sont austères ». On pourrait entendre la même phrase, échangée entre deux producteurs, dans un festival international. C'est que la réflexion que propose le film dépasse son propre cadre : pour un cinéaste cinéphile comme Assayas, elle interroge la transmission de l'histoire du 7e art, et aussi le risque de réification - notamment via ces coffrets DVD qu'il suffit de posséder pour qu'on croie les connaître. Ainsi L'Heure d'été puise-t-il aussi ses racines dans Les Dernières Vacances, de Roger Leenhardt, film-phare de la Nouvelle Vague, oeuvre définitive sur la maison de famille qu'on liquide et le temps qui fuit, elle-même inspirée sans doute par Tchekhov. Le propos s'élargit, et débouche naturellement sur une élégie très poignante : c'est la finitude de l'homme que signale l'éternité des oeuvres et des objets. Beau plan d'Edith Scob, que ses enfants ont quittée, et qui se fond dans le décor de sa maison-musée, déjà comme un fantôme ; douloureuse étreinte de Charles Berling et de Dominique Reymond, face à un vase exposé à Orsay : cet objet enferme quelque chose de leur histoire, qui leur échappe désormais, et il leur survivra. Le musée est bien le lieu de passage « marchandisé » des troupeaux de touristes qui attrapent des bribes de culture, mais c'est aussi le temple qui inspire la terreur de la mort.


