Diffusions passées:

L’Apollonide, souvenirs de la maison close, diffusion du lundi 01 janvier 2018 à 01h35
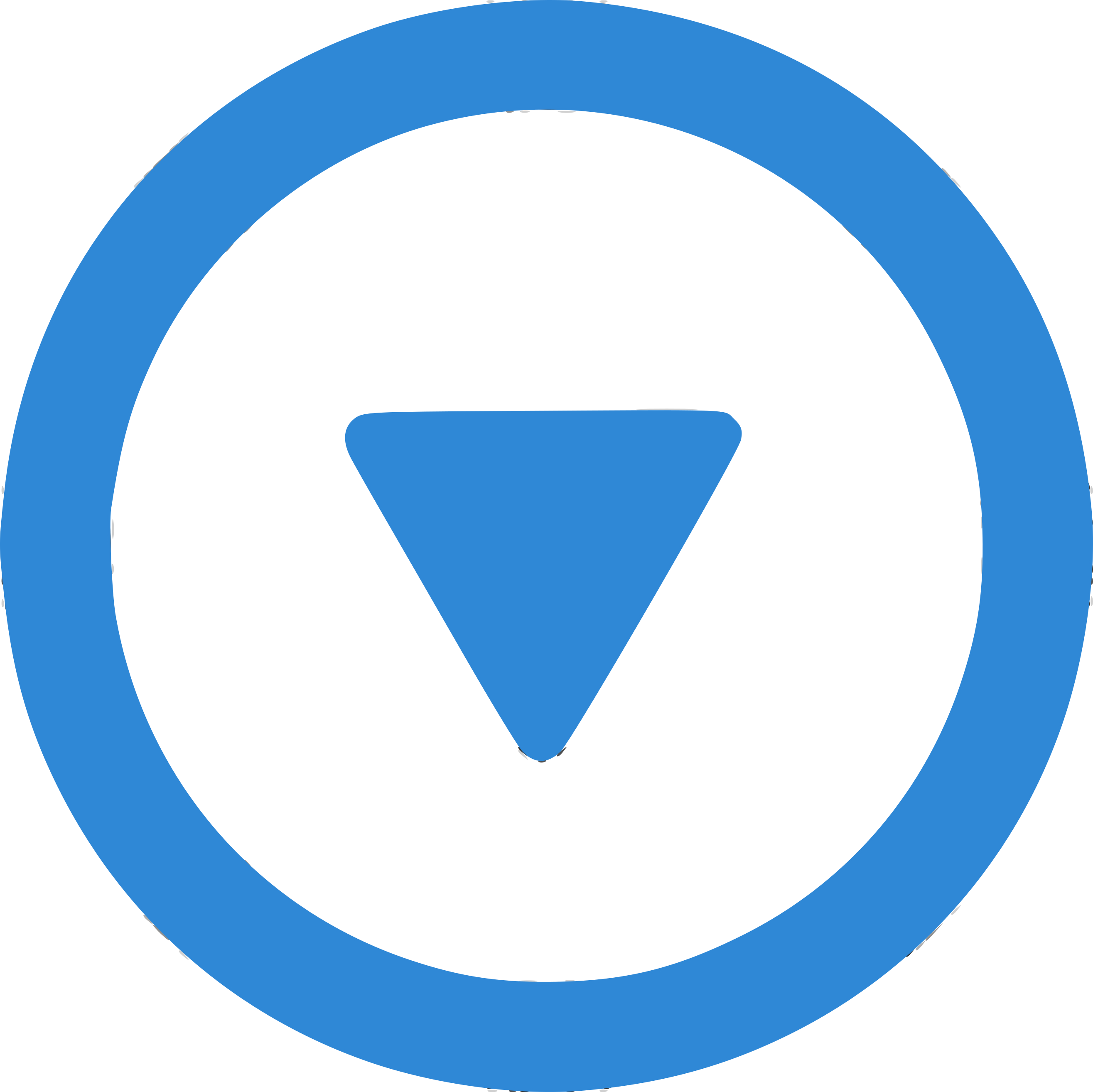
Un choc esthétique et une ode violente, capiteuse, bouleversante à la condition féminine, ou un exercice de style vain et sans émotion. A vous de juger. Critique : POUR Un couloir où se croisent deux filles languides et légèrement vêtues... « Je voudrais dormir mille ans », soupire Clotilde. « Ça ira mieux ce soir », répond Samira. Léa, Madeleine, Julie, Clotilde, Samira sont prostituées dans un bordel de luxe « au crépuscule du XIXe siècle » et « à l'aube du XXe ». Douze fleurs en vase clos offertes aux hommes dans un décor théâtral de velours rouge et vert où coule le champagne et s'évanouissent, peu à peu, leurs espoirs d'émancipation... Grains de peau, cascades de cheveux, regards indolents ou insolents, nudités qui évoquent Renoir ou Manet, le tout filmé avec un sens du cadre et du mouvement : L'Apollonide, cinquième long métrage de Bertrand Bonello, est un choc esthétique. L'un des plus beaux films sur la chair féminine. La première partie du film est la chronique d'un « commerce ». Des combles sombres et vétustes où elles dorment dans de simples chemises de nuit blanches, les filles descendent dans le grand salon, habillées, coiffées, parfumées, comme si elles montaient sur scène. Prêtes à jouer la comédie pour les clients (la plupart interprétés par des... cinéastes). Parmi les réguliers, il y a ce peintre obsédé par l'intérieur de leur sexe, le secret qu'il renferme. Gustave Courbet devant l'origine du monde ? Dans une lettre adressée à sa protégée, un autre habitué écrit : « Les hommes ont des secrets, mais pas de mystère. » C'est ce mystère féminin que Bertrand Bonello capte. Et puis, il y a ce beau jeune homme qui ressemble à Pierre Clémenti dans Belle de jour, de Buñuel. Madeleine, la « juive », lui a raconté un rêve où elle avait peur de lui. Avant, après, on ne sait plus, tant Bertrand Bonello suspend le temps, on saura qu'elle avait raison d'avoir peur... Avec sa bouche tailladée, Madeleine devient « la femme qui rit ». On pense à Victor Hugo, bien sûr, mais aussi au Joker de Batman. Elle devient, alors, un autre objet de désir... Le sourire obligatoire de Madeleine, cette cicatrice indélébile, est la réponse à tous ceux qui voudront voir dans L'Apollonide un film nostalgique sur le bon vieux temps des maisons closes. Car, en coulisses, il y a la peur (vraie scène d'angoisse quand le médecin ausculte les filles l'une après l'autre : saine ou pas ?), les litres d'eau de Cologne comme spermicide et le chantage économique de la mère maquerelle (épatante Noémie Lvovsky, tendre et ferme) qui gère les dettes de ses filles. Ce théâtre des fantasmes n'est rien d'autre qu'une petite entreprise menacée par la crise. La seconde partie du film est le temps de la désillusion. Madame va devoir fermer sa maison. Il faut travailler plus. L'abattage n'est pas loin, les fleurs se fanent dans les vapeurs d'opium, et la syphilis fait une victime. A partir de là, Bertrand Bonello ose tout : l'opéra funèbre à la Coppola, l'irruption du fantastique. Autour du cadavre, les filles entonnent un chant d'esclaves, puis, en larmes, dansent sur Nights in white satin, des Moody Blues : anachronisme musical qu'on aurait tort de prendre pour une coquetterie branchée. « Il faut qu'on brûle pour donner de la lumière », dit une des filles... Une image pourra en faire ricaner certains : Madeleine, la juive, la femme qui rit, pleurant des larmes de sperme, alors qu'une panthère noire s'occupe, enfin, de la venger dans la chambre voisine. Elle pourrait sortir d'un polar à l'italienne, un giallo de Dario Argento. Avec Bonello, elle devient le point d'orgue d'une ode violente à la condition féminine. G.O. CONTRE Bertrand Bonello est un cinéaste excessivement cérébral. La maison close de L'Apollonide n'est pas le bordel qui raconterait la condition de la putain (et de son client) il y a un siècle et des poussières, mais plutôt une pure idée, une installation d'art conceptuel pour chair, velours et dentelles, pièce opaque avec modèles vivants qu'on préférerait visiter dans un musée - ça ne durerait pas deux heures cinq. Nul fantasme érotique : le seul désir à l'oeuvre est un rêve de cinéma postmoderne, vaguement tendance, sérieusement dévitalisé. Il manque au film la capacité d'émouvoir le spectateur par une quelconque progression dramatique ou toute possibilité d'empathie avec ses personnages. Ici, rien de tel. Surtout pas ça ! Dommage pour les vaillantes actrices (Céline Sallette en tête), qui n'ont pas eu froid aux yeux. La succession de saynètes se regarde sans passion, comme on feuilletterait un livre en papier glacé. Vu le sujet, le comble est de priver le film de toute sensualité et d'escamoter une véritable réflexion sur la prostitution. Au point de n'être jamais sûr - et donc convaincu - de ce que L'Apollonide veut vraiment nous raconter... A.F.

L’Apollonide, souvenirs de la maison close, diffusion du vendredi 22 décembre 2017 à 00h40


